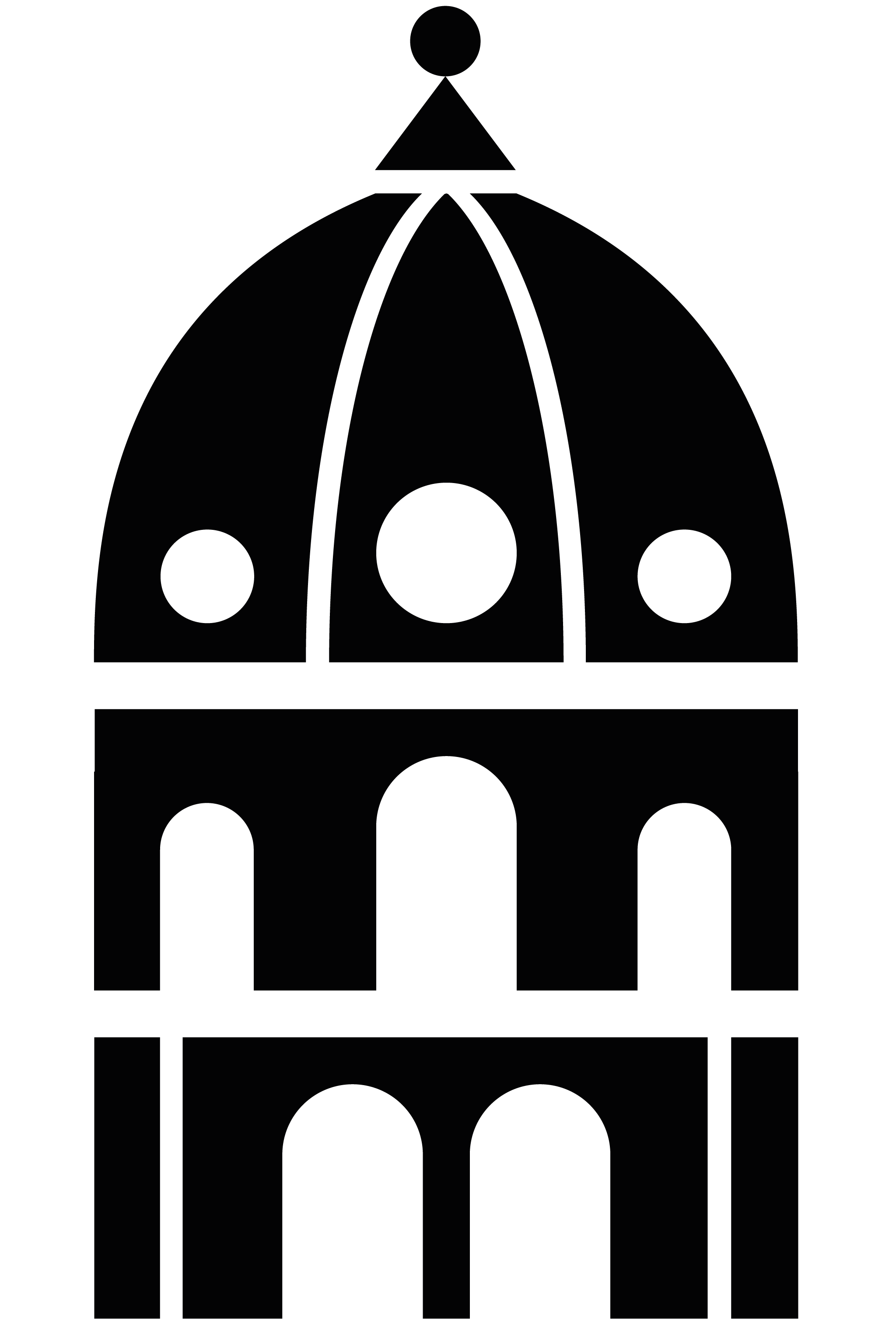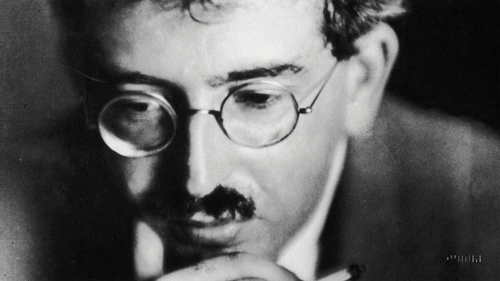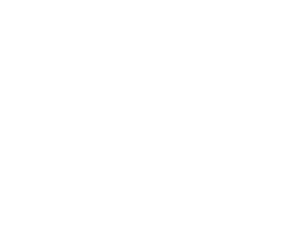À mes débuts dans le grand bain de l’art contemporain, j’étais avide de nouvelles technologies, glouton de connaître tous les artistes numériques qui les employaient dans les manières les plus folles (net art, génératif, interactif, virtuel…). Régnait alors un sentiment à la fois romantique et naïf d’appartenir à une avant-garde artistique, schéma que je découvrais et apprenais en histoire de l’art.
Cette voracité s’est estompée. Avec l’âge, elle a laissé place à une recherche de sacralité dans l’œuvre. J’étais alors plus intéressé par la puissance de l’œuvre, le sentiment profond et universel qu’elle est capable de déclencher. En effet, je ne retrouvais plus cela dans mon si tendre art numérique qui m’apparaissait alors comme un gadget.
Cette introduction très personnelle pour dire qu’aujourd’hui peut-être, les deux portes d’entrée par lesquelles j’ai apprécié l’art peuvent se rencontrer.
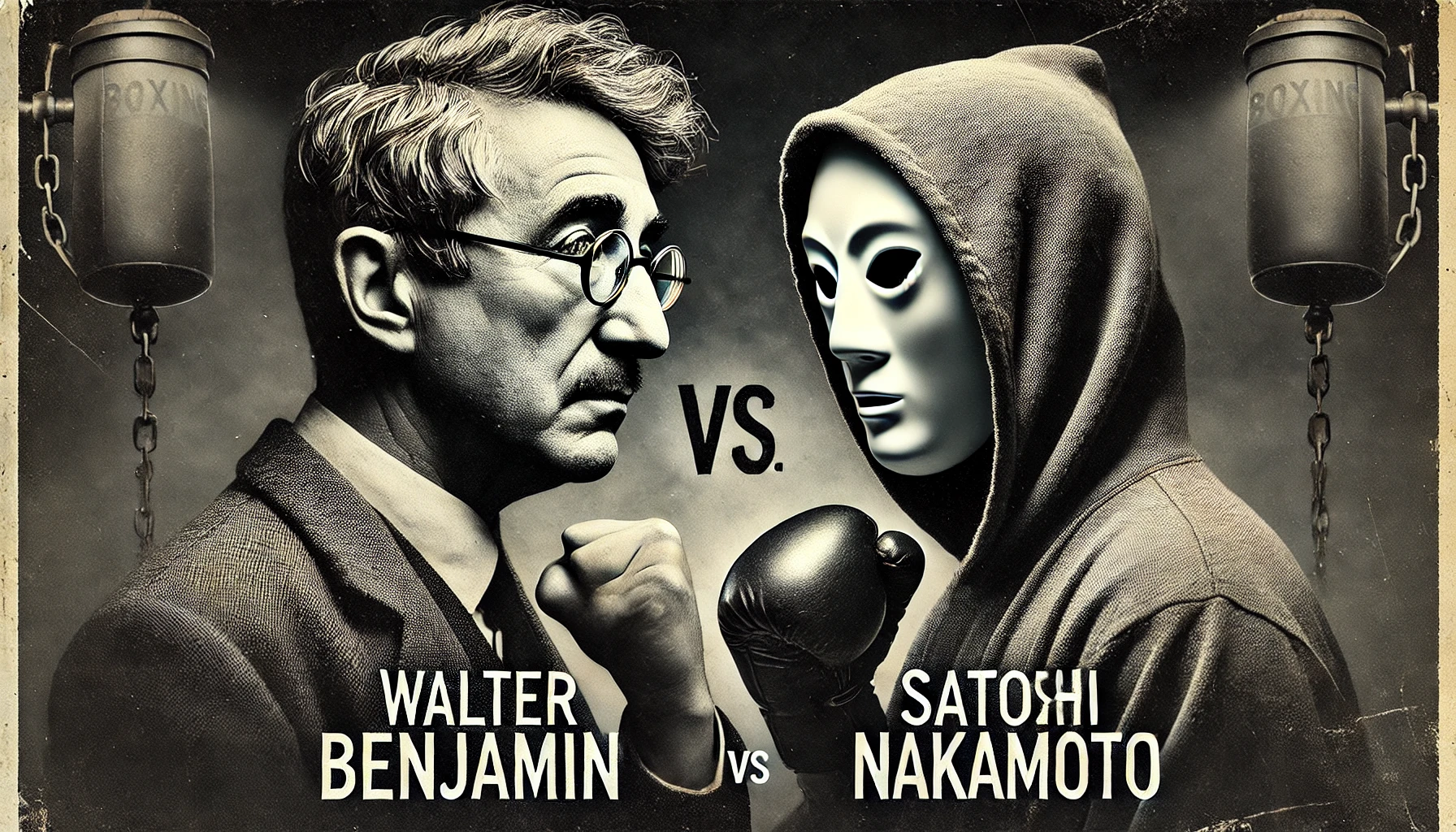
Dans le coin gauche, Walter Benjamin, 1m67 et un poids lourd absolu de la pensée philosophique. Son gabarit intellectuel, imposant, précis, frappe fort dans l’histoire des idées, notamment avec son fameux concept d’« aura ». Pour Benjamin, chaque œuvre d’art originale possède un halo mystérieux d’authenticité, enraciné dans son unicité historique et spatiale, et destiné à disparaître avec l’avènement de la reproductibilité technique. Dans sa vision, l’art perd progressivement cette dimension sacrée, se dissout à travers les reproductions et finit par se transformer en une consommation banalisée, privée d’émotion authentique. Dès les années 30, Benjamin annonce ainsi l’arrivée d’un monde où l’authenticité contemplative cède le pas à la consommation immédiate et infiniment répétée.
Dans ce combat conceptuel, Benjamin ne se contente pas d’observer passivement la perte de l’aura : il souligne comment cette évolution technologique transforme radicalement notre rapport à l’image, à l’histoire, et même à la politique. Selon lui, la reproduction technique libère l’œuvre d’art de son contexte traditionnel, la rendant accessible à tous, partout, instantanément, mais en échange elle en affaiblit le pouvoir critique et contemplatif. Ce phénomène permet une démocratisation sans précédent de la culture, certes, mais ouvre aussi la voie à sa manipulation et à sa banalisation par les médias de masse. Loin d’être nostalgique ou pessimiste, Benjamin place ainsi au cœur du débat une question cruciale : que devient l’art lorsqu’il perd cette aura qui lui conférait sa puissance symbolique ? Comment préserver le sens et la profondeur face à une reproduction infinie et dématérialisée ?
Dans le coin droit, un nouveau champion, Satoshi Nakamoto, taille non précisée, poids non précisé mais vainqueur absolu dans sa catégorie : la révolution du Web3. Face à la perte progressive de l’aura décrite par Benjamin, Nakamoto contre-attaque avec une innovation technique radicale, le bitcoin et sa blockchain. À travers ses diverses lettres et communications, Nakamoto propose une réponse directe au problème fondamental posé par l’ère numérique : comment restaurer la confiance et l’authenticité dans un univers virtuel où tout est reproductible à l’infini ? Sa solution est d’une simplicité apparente mais d’une puissance redoutable : créer, grâce à la cryptographie et à la décentralisation, une rareté algorithmique vérifiable, une unicité inviolable et transparente. Chaque bitcoin existe ainsi comme une entité authentiquement unique, inscrite irrévocablement dans un registre public et distribué. Nakamoto réinvente donc, en quelque sorte, une aura numérique, non fondée sur l’histoire ou la contemplation esthétique, mais sur la preuve mathématique et une confiance collective inédite. Ce concept redéfinit profondément notre perception de la valeur et de l’authenticité, imposant un nouveau paradigme où l’unicité ne s’évalue plus dans l’espace physique, mais dans la certitude cryptographique absolue.
Satoshi Nakamoto, le bitcoin et la blockchain dessinent-ils les contours d’un retour de l’aura perdue, d’une renaissance inattendue ? Ce serait, en quelque sorte, le début de la fin du règne absolu de la reproductibilité infinie décrite par Benjamin. Alors même que le numérique semblait définitivement condamner l’œuvre authentique, la blockchain propose une inversion spectaculaire du phénomène : elle restaure, au cœur même de l’immatériel, l’idée d’une unicité certifiée et inviolable. Certes, cette « aura 2.0 » n’est plus ancrée dans la contemplation esthétique traditionnelle, mais dans une nouvelle forme d’authenticité algorithmique et cryptographique. Le bitcoin et la blockchain pourraient marquer une première étape vers une redéfinition profonde de notre rapport à l’unique et au rare, offrant une piste inattendue, mais fascinante, pour réinventer l’aura au cœur même d’une époque qui semblait avoir signé son acte de décès.