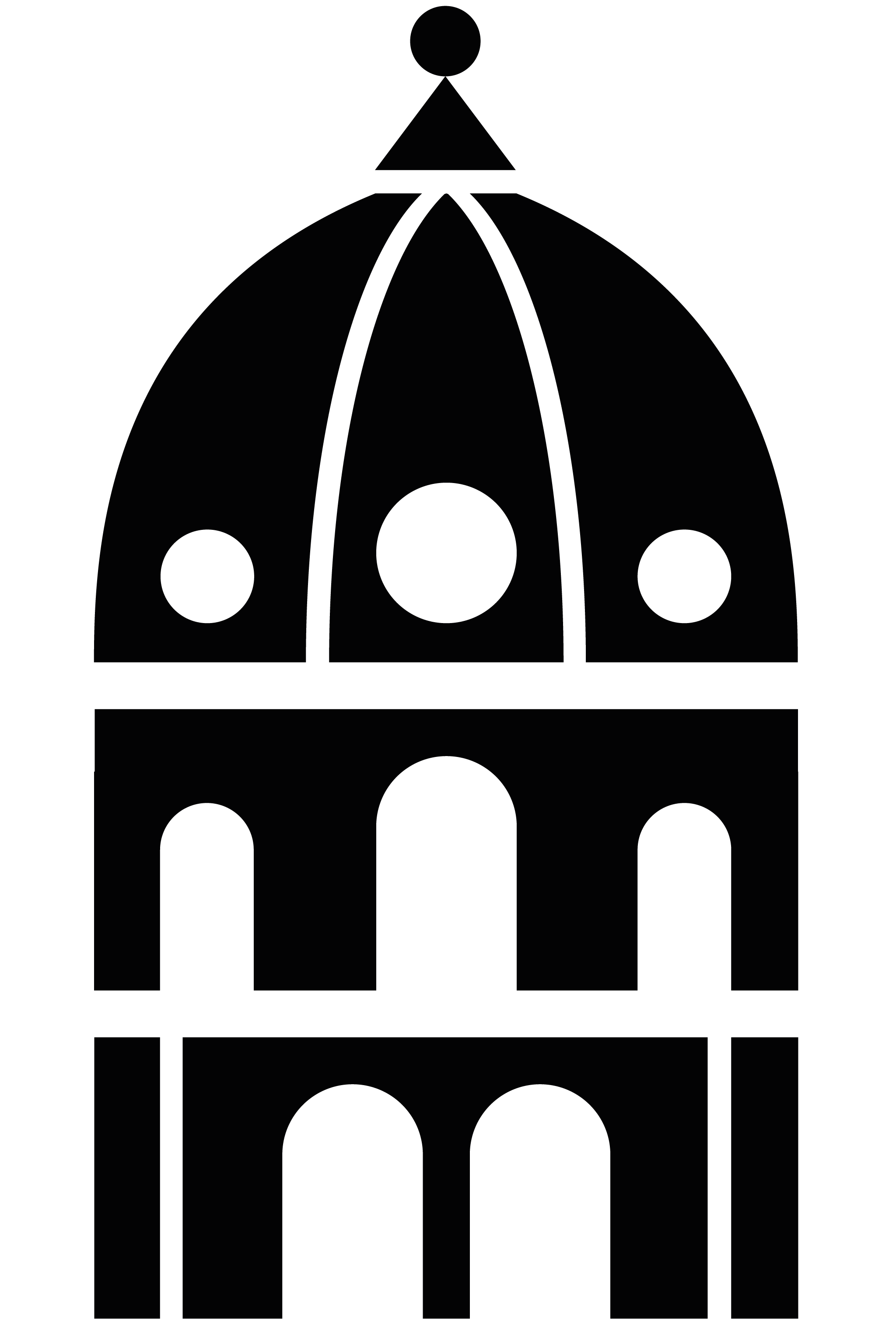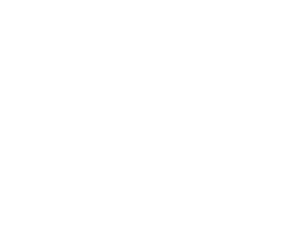Une sculpture imposante, formée de neuf cercles métalliques entrelacés tournant sur leur axe. De diamètres différents, ils reposent délicatement l’un sur l’autre, suggérant à la fois une mise en équilibre fragile et précaire, mais également une stabilité certaine.
Comme suspendus, ces anneaux semblent hésiter entre effondrement et solidité, entre chaos et ordre.
Avec CYCLES (2025), l’artiste espagnol SpY prolonge sa démarche créative consistant à interroger l’espace public au travers d’interventions simples mais spectaculaires.
Connu pour ses installations urbaines dans le monde entier, SpY déplace ici sa réflexion : au lieu de révéler un lieu par contraste, il impose une forme autonome qui attire, capte et absorbe le spectateur.
Le spectateur acteur : une esthétique relationnelle ?
Lorsque l’on se retrouve devant cette structure métallique, le doute s’installe : est-ce une architecture figée ou une sculpture en perpétuelle transformation ? Ici, on n’est plus passif : le spectateur devient acteur. Par ses déplacements, il active l’œuvre et en révèle les multiples combinaisons optiques.
Chaque pas dévoile une nouvelle illusion de profondeur et de mouvement, chaque angle recompose le dessin des anneaux. Cette interaction résonne directement avec l’esthétique relationnelle telle que théorisée par Nicolas Bourriaud¹ : l’œuvre devient un dispositif qui organise des relations, où l’expérience individuelle et collective prime et/ou complète l’objet matériel.

Héritages artistiques : futurisme, cinétisme et minimalisme
Ce dialogue avec la perception et l’illusion du mouvement nous ramène d’abord au futurisme², qui célébrait l’énergie et la vitesse de la modernité.
On pense ensuite à l’art cinétique, où le mouvement réel ou suggéré constituait la matière même de l’œuvre : les illusions visuelles de SpY rappellent celles de Soto ou Calder³.
Enfin, par sa sobriété formelle et ses matériaux industriels, CYCLES convoque le minimalisme, qui, en réduisant les formes à leur clarté géométrique, concentrait toute l’attention sur la pure expérience sensible du spectateur.
Cercles et ellipses : le legs d’Apollonius
Mais CYCLES ne se lit pas seulement à travers les avant-gardes modernes. Son essence peut également renvoyer à une tradition antique. Les cercles qui deviennent ellipses selon l’angle et la vitesse de rotation rappellent les travaux d’Apollonius de Perge (IIIe–IIe siècle av. J.-C.), surnommé le « Grand Géomètre ». Dans son traité des Coniques⁴, il montrait déjà comment un cercle se métamorphose en ellipse, parabole ou hyperbole selon la perspective et la coupe.
On peut arguer que SpY transpose ces abstractions mathématiques dans l’espace public, faisant vivre au spectateur ce que l’Antiquité avait formalisé comme équations.

En fin de compte, CYCLES de Spy apparaît comme une œuvre hybride, inscrite à la croisée des mathématiques antiques, des avant-gardes modernes et des pratiques relationnelles contemporaines. Ici, mouvement et temps deviennent des matériaux sculpturaux.
L’installation nous invite à repenser la sculpture non comme un objet fini, mais comme la conséquence d’un mouvement, une chorégraphie fragile et infinie qui transforme autant notre regard que notre place dans l’espace.
Notes
[1] Nicolas Bourriaud
Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Les Presses du Réel, 1998.
Bourriaud définit une nouvelle catégorie artistique fondée sur la production de relations sociales et de micro-utopies partagées entre spectateurs, plutôt que sur la fabrication d’objets autonomes.
[2] Futurisme
Filippo Tommaso Marinetti, Manifeste du Futurisme, 1909.
Mouvement italien glorifiant la vitesse, la technologie, la guerre et l’énergie de la modernité.
Dans ce contexte, la circularité mécanique de CYCLES peut être vue comme un écho critique et poétique à cette exaltation.
[3] Jesús Rafael Soto (1923–2005) et Alexander Calder (1898–1976).
Soto : illusions d’optique vibrantes, jeux visuels entre stabilité et instabilité.
Calder : invention du mobile, où le mouvement réel est au cœur de la sculpture.
[4] Apollonius de Perge :
Coniques, IIIe–IIe siècle av. J.-C.
Ouvrage en huit livres, dont sept sont parvenus.
Apollonius y développe une classification des courbes issues des sections d’un cône (cercle, ellipse, parabole, hyperbole). Ces figures sont fondamentales pour la géométrie projective et l’astronomie.

Photos : Barthélemy de Mélo ©Coyau / Édition de 1654 de Conica édité par Francesco Maurolico